 C’est ma période fix-up. Cette fois, il s’agit d’un livre culte de la SF française : Les soldats de la mer, d’Yves et Ada Rémy, dont j’ai lu récemment Le Mont 84, chroniqué ici. Les soldats de la mer a été publié une première fois en 1968, et est réédité régulièrement depuis. Dystopia est le dernier éditeur en date. Cette maison d’édition, à qui ont doit aussi Le Mont 84 a aussi prévu d’autres rééditions de ces auteurs, le prochain étant La Maison du Cygne.
C’est ma période fix-up. Cette fois, il s’agit d’un livre culte de la SF française : Les soldats de la mer, d’Yves et Ada Rémy, dont j’ai lu récemment Le Mont 84, chroniqué ici. Les soldats de la mer a été publié une première fois en 1968, et est réédité régulièrement depuis. Dystopia est le dernier éditeur en date. Cette maison d’édition, à qui ont doit aussi Le Mont 84 a aussi prévu d’autres rééditions de ces auteurs, le prochain étant La Maison du Cygne.
Mais revenons aux Soldats de la mer. Les nouvelles sont situées sur un autre monde, sorte de monde parallèle (on en apprend plus sur ce qu’est vraiment ce monde au fil des nouvelles, et la dernière explique pas mal de choses) ressemblant à la Terre, mais dont les nuits sont éclairées par deux lunes. Les différentes nations se font souvent la guerre, puis peu à peu, se fédèrent entre elles. Le recueil peut être vu comme la construction au fil du temps de cette fédération, pas d’un point de vue général, mais par petites touches, par des histoires de personnages qui ont jalonné la construction de cet ensemble politique. Le sous-titre du livre résume cela à merveille : Chroniques illégitimes sous la Fédération.
Les nouvelles des Soldats de la mer sont donc principalement des récits de guerre. Mais elles sont toutes teintées de fantastique : fantôme ou mort-vivants, vampires, mondes parallèles, sirènes… Yves et Ada Rémy revisitent les mythes de façon subtile, en clair obscur. L’aspect fantastique est suggéré plus qu’il n’est affirmé. Cela donne à l’ensemble une ambiance toute particulière, et la beauté de l’écriture ne gâche rien, bien au contraire.
En refermant ce livre, une chose frappe : son intemporalité. Près de 50 ans plus tard, Les soldats de la mer est un livre absolument pas daté. Traverser 50 ans sans prendre une ride, pour un livre, c’est quand même pas fréquent. Et pour magnifier cette jeunesse éternelle, Dystopia a concocté un joli écrin à la hauteur du bijou. Une couverture magnifique (jusque dans les moindres détails, cf. le traitement du code-barre sur le rabat intérieur), une mise en page propre et sans coquille (ça devrait être la norme, mais bon nombre de petits éditeurs ne peuvent en dire autant…)
Indispensable dans toute bibliothèque, surtout d’un amateur de littératures de mauvais genre !
Paru aux Éditions Dystopia

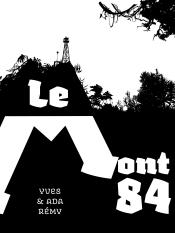 Un roman inédit d’Yves et Ada Rémy, on avait pas vu ça depuis bien longtemps. Quant ils ont pris conscience, dans les années 70, que la littérature ne leur permettrait pas de vivre, ils l’ont un peu délaissé. Les éditions Dystopia ont récemment réédité une partie de leur œuvre. Maintenant à la retraite, Yves et Ada Rémy peuvent revenir à la plume.
Un roman inédit d’Yves et Ada Rémy, on avait pas vu ça depuis bien longtemps. Quant ils ont pris conscience, dans les années 70, que la littérature ne leur permettrait pas de vivre, ils l’ont un peu délaissé. Les éditions Dystopia ont récemment réédité une partie de leur œuvre. Maintenant à la retraite, Yves et Ada Rémy peuvent revenir à la plume.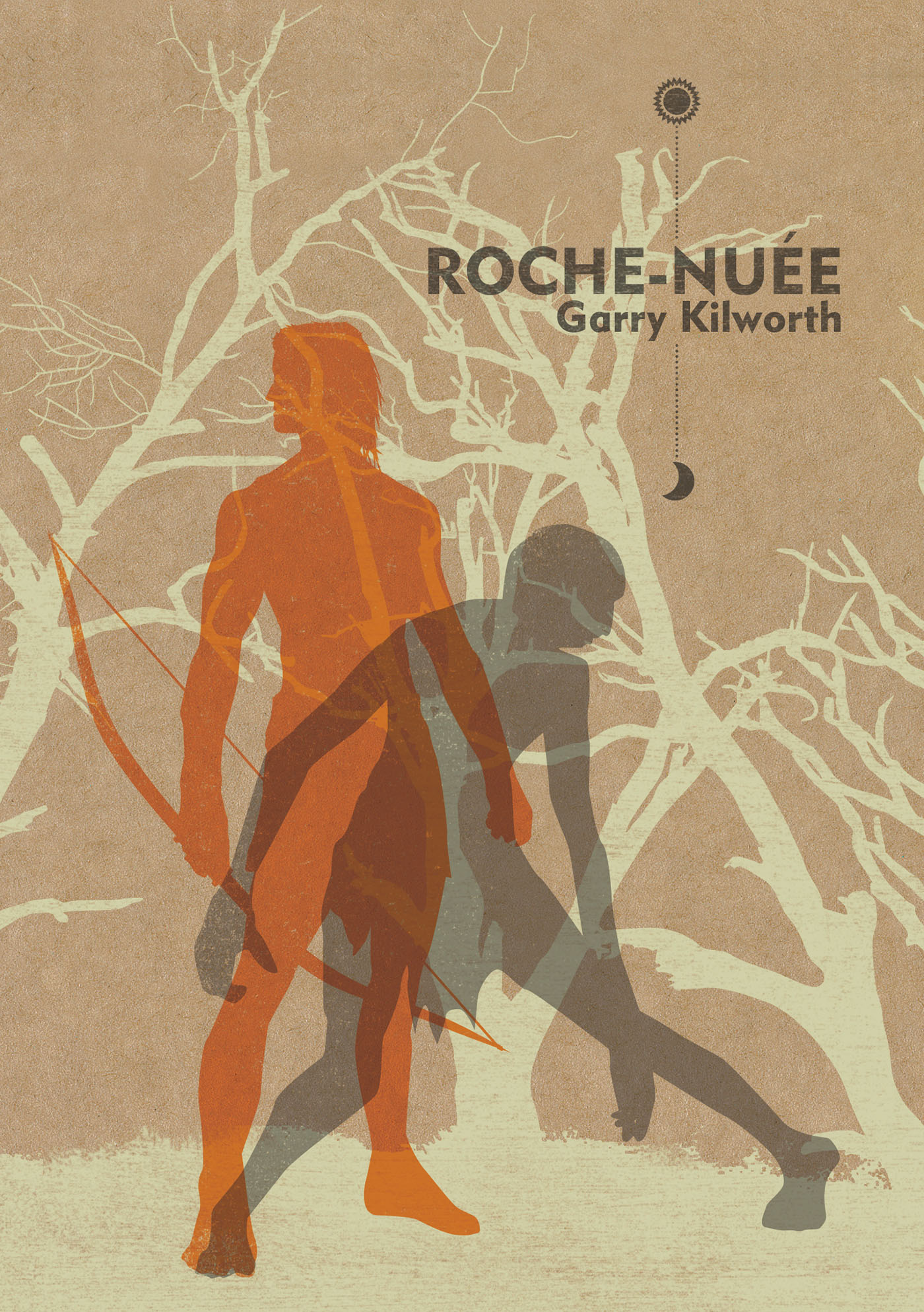 Ça y est, les éditions Scylla sont nées. Après une campagne de financement participatif rondement menée, les deux premiers volumes sont en vente. J’ai déjà chroniqué leur premier titre, une novella de Sébastien Juilliard
Ça y est, les éditions Scylla sont nées. Après une campagne de financement participatif rondement menée, les deux premiers volumes sont en vente. J’ai déjà chroniqué leur premier titre, une novella de Sébastien Juilliard 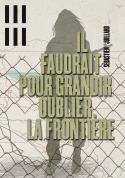 La création d’une maison d’édition est une aventure qui se fait rare, et est surtout très hasardeuse. La librairie Scylla, située à Paris dans le XIIe arrondissement, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé un financement participatif pour créer Les éditions Scylla, avec un programme de lancement de deux titres, dont la novella chroniquée ci-après. Celle-ci est la première, d’une, je l’espère, longue série de textes d’exactement 111 111 signes, ce nombre devenant le nom de la collection. (Le deuxième titre est la réédition d’un roman de Garry Kilworth : Roche-Nuée).
La création d’une maison d’édition est une aventure qui se fait rare, et est surtout très hasardeuse. La librairie Scylla, située à Paris dans le XIIe arrondissement, spécialisée dans les littératures de l’imaginaire, a lancé un financement participatif pour créer Les éditions Scylla, avec un programme de lancement de deux titres, dont la novella chroniquée ci-après. Celle-ci est la première, d’une, je l’espère, longue série de textes d’exactement 111 111 signes, ce nombre devenant le nom de la collection. (Le deuxième titre est la réédition d’un roman de Garry Kilworth : Roche-Nuée). En pleine révolution zapatiste dans le Chiapas, au Mexique, quatre américains sont confrontés aux mythes ancestraux du pays où vivaient les Mayas il y a bien longtemps. Voilà le pitch, en une phrase d’En des cités désertes, de Lewis Shiner. John Carmichael, un grand reporter, est à la recherche du scoop de sa vie. Thomas et Lindsey recherchent Eddy, frère de Thomas et ex-mari de Lindsey, disparu dix ans avant, qu’ils croyaient morts, et qu’ils ont vu sur une photo de magazine récent.
En pleine révolution zapatiste dans le Chiapas, au Mexique, quatre américains sont confrontés aux mythes ancestraux du pays où vivaient les Mayas il y a bien longtemps. Voilà le pitch, en une phrase d’En des cités désertes, de Lewis Shiner. John Carmichael, un grand reporter, est à la recherche du scoop de sa vie. Thomas et Lindsey recherchent Eddy, frère de Thomas et ex-mari de Lindsey, disparu dix ans avant, qu’ils croyaient morts, et qu’ils ont vu sur une photo de magazine récent. À 68 ans, Jacques Baudou (critique littéraire, essayiste, et anthologiste bien connu des passionnés des littératures de l’imaginaire) publie son premier roman.
À 68 ans, Jacques Baudou (critique littéraire, essayiste, et anthologiste bien connu des passionnés des littératures de l’imaginaire) publie son premier roman.