
Quelle mouche a donc piqué François Hollande lorsqu’il est venu proposer aux deux chambres réunies en congrès à Versailles une révision de la Constitution intégrant la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux, vieille revendication de l’extrême droite et de la droite dure depuis des années ? Était-il obnubilé par l’unité nationale au point de croire qu’elle consistait à s’emparer des thèses les plus dures du camp adverse, et confondant par là même unité nationale et ralliement à l’adversaire (une conception bien cynique, mais qu’on voit se mettre en place depuis trois ans sur tous les plans : si la gauche se rallie aux idées de la droite, alors, dans les faits, on peut donner à croire que tout le pays est d’accord sur tout, oubliant que les appareils politiques ne sont pas le reflet des opinions) ?
La boîte de Pandore ouverte, arriva ce qui devait arriver : un déferlement d’idioties sur le sujet, autant chez les défenseurs du projet que chez ses opposants, démontrant, les uns et les autres, qu’ils parlaient du sujet sans connaître l’histoire et la réalité de notre code de la nationalité.
Ce n’est pas le moindre des mérites du petit livre de Christiane Taubira, Murmures à la jeunesse : elle met en perspective notre code de la nationalité, retrace son parcours mouvementé, ancré dans notre Histoire commune, cette Histoire commune qui fait Nation, ce mot qui envahit, à tort et à travers la bouche de nos gouvernants pour masquer leur impuissance.
Rappelons en deux mots le projet constitutionnel. Aujourd’hui, on peut déchoir de sa nationalité française des citoyens ayant acquis cette nationalité par naturalisation, durant quelques années qui suivent cette naturalisation (dix ans, je crois). Pour des faits extrêmement graves, bien entendu, dont les crimes de terrorisme. C’est le seul cas prévu par la loi (alors qu’il existe bien des façons d’être français). L’idée est de l’étendre à tous les Français, mais, comme des traités dont nous sommes signataires nous interdisent de rendre des gens apatrides, un petit génie a eu l’idée magnifique de l’étendre aux Français binationaux, c’est-à-dire des gens qui sont nés français, mais qui, par les hasards de l’histoire, ont aussi une autre nationalité. Le Conseil d’État ayant jugé ce projet peu compatible avec la constitution, notre président décida de proposer de changer celle-ci !
Penchons-nous un moment sur les idioties proférées depuis cette annonce. Certains opposants au projet ont déclaré que cela remettrait en cause le droit du sol. Hors sujet ! On peut être binational en ayant acquis la nationalité française par droit du sang (je rappelle qu’est français tout enfant dont l’un des parents est français – où qu’il soit né). Quant aux défenseurs du projet, la liste des bêtises est bien plus longue. Christiane Taubira répond à ceux-ci, en remettant le débat au niveau qu’il n’aurait jamais dû quitter : pourquoi la nationalité n’est pas un droit parmi d’autres, mais un droit fondamental, inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme.
Cette mesure infâme (et infamante pour celui qui la propose) serait la réponse au fait qu’un terroriste, par ses actes, s’exclut de la communauté nationale. Il serait difficile de dire l’inverse, mais c’est là que le bât blesse : la communauté nationale n’est pas liée à la nationalité. La Nation, en revanche, est responsable de ses « enfants ». C’est elle qui juge et punit. On ne renvoie pas ses enfants qui ont commis un crime, fut-il le pire. D’autant que certains zélés trouvent déjà qu’il ne faudrait pas restreindre la mesure aux crimes, mais l’étendre aux délits.
« Osons le dire : un pays doit être capable de se débrouiller avec ses nationaux. Que serait le monde si chaque pays expulsait ses nationaux de naissance considérés comme indésirables ? Faudrait-il imaginer une terre-déchetterie où ils seraient regroupés ? Quel aveu représente le fait qu’un pays n’ait les moyens ni de coercition ni de la persuasion envers l’un de ses ressortissants ? Quel message d’impuissance, réelle ou présumée, une nation enverrait-elle ainsi ? »
Par ces questions et les réponses qu’elle y apporte, Christiane Taubira aborde le deuxième thème fort de son livre : le questionnement sur les causes de l’embrigadement de jeunes gens dans le djihadisme. Ce questionnement que Manuel Valls avait balayé d’un coup de menton avec cette phrase terrible : « Pour ces ennemis qui s’en prennent à leurs compatriotes, qui déchirent ce contrat qui nous unit, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser ».
Manuel Valls serait bien inspiré de relire (je ne lui fais pas un procès en inculture en écrivant lire au lieu de relire…) Hannah Arendt, pour qui « C’est dans l’absence de la pensée que s’inscrit le mal ».
Christiane Taubira insiste aussi sur la fonction protectrice de la constitution. Elle est là pour définir nos grands principes. Lorsqu’on s’inquiète de la portée du texte, l’exécutif répond qu’il ne concerne que les terroristes. Alors, pourquoi inclure les mots suivant « définitivement condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » dans le texte (on verra s’ils sont bien repris dans le texte définitif) ? Lorsqu’on s’apprête à donner les clés du pays à une Marine Le Pen, on devrait réfléchir à deux fois avant de bricoler la Constitution. Quelle serait la définition que donnerait un gouvernement autoritaire de l’« atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation » ?
Quelques jours après avoir écrit ce court texte (moins de 100 pages), et quelques jours avant sa parution, Christiane Taubira démissionnait, enfin, du gouvernement. Comment en aurait-il pu être autrement alors qu’elle conclut son texte par :
« Je ne suis sûre de rien, sauf de ne jamais trouver la paix si je m’avisais de bâillonner ma conscience ».
Le texte se veut être une adresse à la jeunesse, mais concerne bien tout le monde. Écrit de la belle langue qu’elle utilise lors de ces plus beaux discours (celui qui concluait la discussion parlementaire sur le mariage pour tous, par exemple), truffé des citations poétiques qu’elle affectionne (quitte à parfois se mélanger les pinceaux, comme lorsqu’elle attribue la chanson La Quête à Jean Ferrat, alors qu’elle est de Brel), c’est un message clair, fort et essentiel en ces temps de confusion intellectuelle et de pauvreté de la pensée.
Paru aux Éditions Philippe Rey

 Le Nexus du Dr Erdmann, de Nancy Kress, est le deuxième titre paru dans la collection « Une heure lumière » des Éditions Le Bélial. Il a obtenu le prix Hugo dans sa catégorie en 2009.
Le Nexus du Dr Erdmann, de Nancy Kress, est le deuxième titre paru dans la collection « Une heure lumière » des Éditions Le Bélial. Il a obtenu le prix Hugo dans sa catégorie en 2009.
 Deux ans après En finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis publie son deuxième roman : Histoire de la Violence, que l’on sentait attendu au tournant par certains, mais aussi attendu tout court par d’autres, dont je fais partie, ceux qui ont été frappés par le talent du jeune auteur (voir
Deux ans après En finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis publie son deuxième roman : Histoire de la Violence, que l’on sentait attendu au tournant par certains, mais aussi attendu tout court par d’autres, dont je fais partie, ceux qui ont été frappés par le talent du jeune auteur (voir 
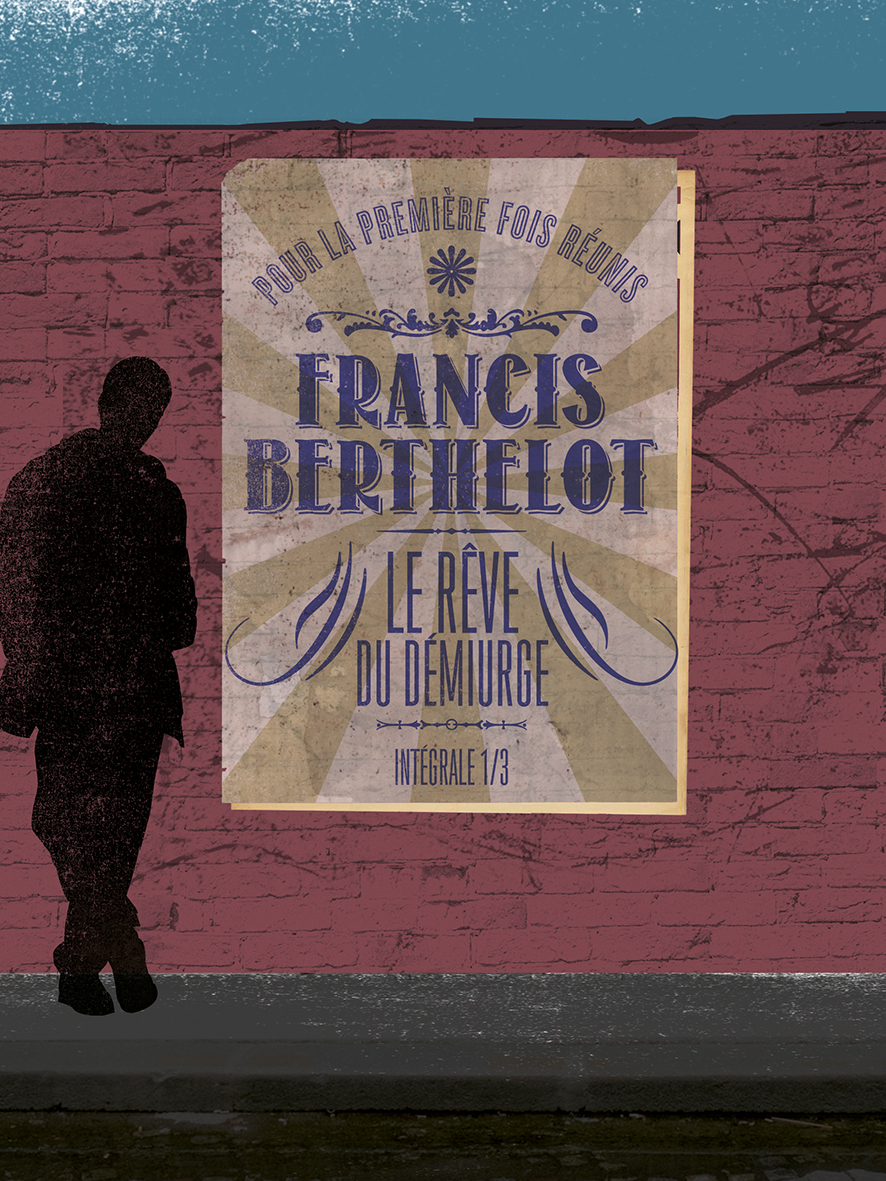 Le Rêve du Démiurge de Francis Berthelot est un cycle de neuf livres dont le dernier vient de paraître, après une odyssée éditoriale compliquée, puisque ce ne sont pas moins de six maisons d’édition qui ont participé à la naissance de ces neufs romans.
Le Rêve du Démiurge de Francis Berthelot est un cycle de neuf livres dont le dernier vient de paraître, après une odyssée éditoriale compliquée, puisque ce ne sont pas moins de six maisons d’édition qui ont participé à la naissance de ces neufs romans.


 Deuxième tome de la trilogie du « subtil changement », Hamlet au Paradis se situe temporellement quinze jours après Le Cercle de Farthing (chroniqué
Deuxième tome de la trilogie du « subtil changement », Hamlet au Paradis se situe temporellement quinze jours après Le Cercle de Farthing (chroniqué 
 Lorsqu’on pense à des nouvelles de Christopher Priest, si l’on connaît un peu l’auteur, ce sont celles se déroulant dans l’univers de l’Archipel du Rêve qui viennent d’abord à l’esprit (voir
Lorsqu’on pense à des nouvelles de Christopher Priest, si l’on connaît un peu l’auteur, ce sont celles se déroulant dans l’univers de l’Archipel du Rêve qui viennent d’abord à l’esprit (voir  Petit enfer dans la bibliothèque est le septième opus de la série Thursday Next, de Jasper Fforde. Les premiers romans de la série sont des merveilles d’humour absurde, et de finesse. Fforde a imaginé un monde dans lequel la littérature est vivante. À côté de la réalité, il existe le monde des livres, dans lequel les histoires fictionnelles sont jouées par les personnages des romans. Des bandits s’escriment à vouloir modifier le patrimoine littéraire, et une police est chargée de faire respecter les histoires telles qu’elles ont été écrites. Sur cette base complètement loufoque, Jasper Fforde fait prospérer son imagination galopante, mais aussi, mine de rien, sa culture littéraire plutôt étendue, ce qui donne des romans à plusieurs niveaux de lecture tout à fait délicieux.
Petit enfer dans la bibliothèque est le septième opus de la série Thursday Next, de Jasper Fforde. Les premiers romans de la série sont des merveilles d’humour absurde, et de finesse. Fforde a imaginé un monde dans lequel la littérature est vivante. À côté de la réalité, il existe le monde des livres, dans lequel les histoires fictionnelles sont jouées par les personnages des romans. Des bandits s’escriment à vouloir modifier le patrimoine littéraire, et une police est chargée de faire respecter les histoires telles qu’elles ont été écrites. Sur cette base complètement loufoque, Jasper Fforde fait prospérer son imagination galopante, mais aussi, mine de rien, sa culture littéraire plutôt étendue, ce qui donne des romans à plusieurs niveaux de lecture tout à fait délicieux. Cinq ans après Les Éclaireurs, qui était lui même suite des Falsificateurs, Antoine Bello a jugé nécessaire de revenir dans l’univers de ces romans pour écrire Les Producteurs.
Cinq ans après Les Éclaireurs, qui était lui même suite des Falsificateurs, Antoine Bello a jugé nécessaire de revenir dans l’univers de ces romans pour écrire Les Producteurs. Que dire de Gagner le guerre qui n’ait été déjà dit ? Le premier roman de Jean-Philippe Jaworski, paru en 2009 a reçu un concert de louanges dès sa sortie. Il se situe dans le même univers que le recueil de nouvelles Janua Vera paru quelques années auparavant, et déjà très remarqué. Il se trouve que depuis tout ce temps, ces deux livres se trouvaient dans ma bibliothèque et que je n’avais jamais pris le temps de les lire.
Que dire de Gagner le guerre qui n’ait été déjà dit ? Le premier roman de Jean-Philippe Jaworski, paru en 2009 a reçu un concert de louanges dès sa sortie. Il se situe dans le même univers que le recueil de nouvelles Janua Vera paru quelques années auparavant, et déjà très remarqué. Il se trouve que depuis tout ce temps, ces deux livres se trouvaient dans ma bibliothèque et que je n’avais jamais pris le temps de les lire.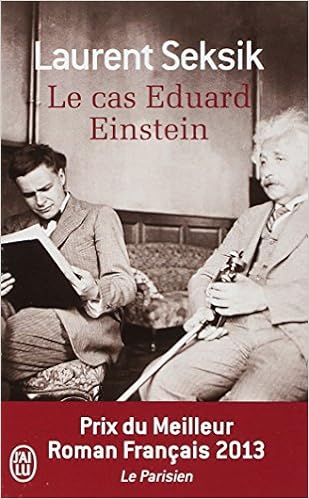 Il y a 100 ans exactement, Einstein publiait la Théorie de la Relativité Générale, révolutionnant la physique pour longtemps.
Il y a 100 ans exactement, Einstein publiait la Théorie de la Relativité Générale, révolutionnant la physique pour longtemps. Kirinyaga est un fix-up (oui, je sais, encore un !) de Mike Resnick, publié pour la première fois en France en 1998, et que la collection Lunes d’Encre, de Denoël, vient de rééditer, dans un volume complété d’une longue nouvelle située dans le même univers, mais se déroulant bien après.
Kirinyaga est un fix-up (oui, je sais, encore un !) de Mike Resnick, publié pour la première fois en France en 1998, et que la collection Lunes d’Encre, de Denoël, vient de rééditer, dans un volume complété d’une longue nouvelle située dans le même univers, mais se déroulant bien après.